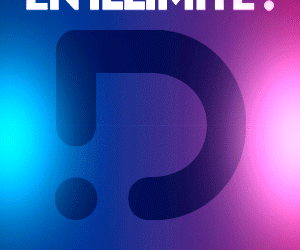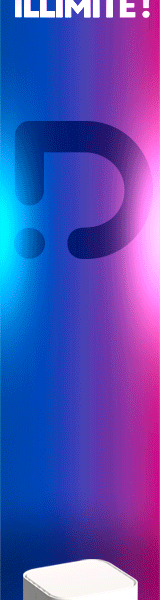Saint-Martin renforce son plan d’action pour sauver ses récifs coralliens
Face aux récifs, mangroves et herbiers qui continuent de se dégrader rapidement, la réunion annuelle du comité local de l’IFRECOR (Initiative Française pour les Récifs Coralliens), s’est tenue ce vendredi 14 novembre dernier. Présidé par le préfet, Cyrille Le Vély, cette rencontre marque un moment clé pour finaliser et valider les fiches d’actions qui guideront les interventions des prochaines années.
Créée en 1999, l’IFRECOR coordonne la protection de ces écosystèmes essentiels dans les territoires d’outre-mer. Saint-Martin dispose depuis le 10 janvier 2024 de son propre comité, après avoir longtemps été rattachée à la Guadeloupe. Il fonctionne selon des programmes d’actions quinquennaux.
Après une première réunion consacrée à la mise en place du comité et une deuxième à l’élaboration du plan local, cette troisième rencontre avait pour objectif de finaliser les 16 fiches d’actions prioritaires parmi les 26 prévues. Le plan s’inscrit dans le programme national et décline des enjeux adaptés à Saint-Martin : réduction des pressions humaines, restauration des récifs et des habitats, cartographie des fonds marins, gestion des espèces exotiques envahissantes, élaboration d’une liste rouge des espèces menacées, suivi scientifique, valorisation socio-économique et renforcement de la communication.
Un état des lieux alarmant
Les travaux se déroulent dans un contexte particulièrement préoccupant. Comme l’a rappelé Julien Chalifour, directeur adjoint de la Réserve naturelle, les récifs coralliens représentent 25 % de la biodiversité marine et jouent un rôle vital pour les îles tropicales : protection contre la houle, ressources alimentaires, soutien au tourisme, régulation écologique. Pourtant, aucun des huit sites de suivi de Saint-Martin n’est aujourd’hui en bon état. « Quatre sont en état médiocre, trois en mauvais et une en moyenne » souligne Julien Chalifour. La couverture corallienne a chuté de 15 % à 6 % en une décennie, fragilisée par les épisodes de canicule marine de 2023 et 2024 qui ont provoqué un blanchissement massif et de fortes mortalités.
Concernant les herbiers, si ceux-ci affichent une certaine stabilité, leur densité est cependant en légère baisse et le changement d’espèce dominante traduit un état instable. Les mangroves, quant à elles, ont perdu près de la moitié de leur surface depuis les années 1950, réduites à environ 24 hectares dans la partie française. Leur déclin, aggravé par l’ouragan Irma, augmente la vulnérabilité du littoral face aux tempêtes et à la montée des eaux.
Sargasses, érosion du littoral et pressions humaines
Le phénomène des sargasses accentue encore les difficultés. Si ces algues jouent un rôle écologique positif en mer, leur accumulation sur la côte entraîne pollution, émissions de gaz, destruction de sites de ponte pour les tortues et asphyxie des herbiers et des récifs. Leur volume mondial est passé de 2,5 millions de tonnes en 2011 à plus de 28 millions aujourd’hui, révélant une tendance durable. L’érosion du trait de côte s’est par ailleurs aggravée de 63 % en six ans, comme en témoigne la plage de Grand-Case où la mer atteint désormais les marches du bar Le Calmos.
Les activités humaines exercent également une pression croissante : la Réserve naturelle a enregistré cette année 270 demandes d’autorisation de travaux en mer provenant de 90 entreprises. Les autorités rappellent que les actions engagées ne visent pas seulement à préserver l’environnement mais aussi à protéger les conditions de vie des populations. « Une île tropicale sans récifs est une île vouée à disparaître » rappelle le directeur adjoint de la Réserve naturelle.